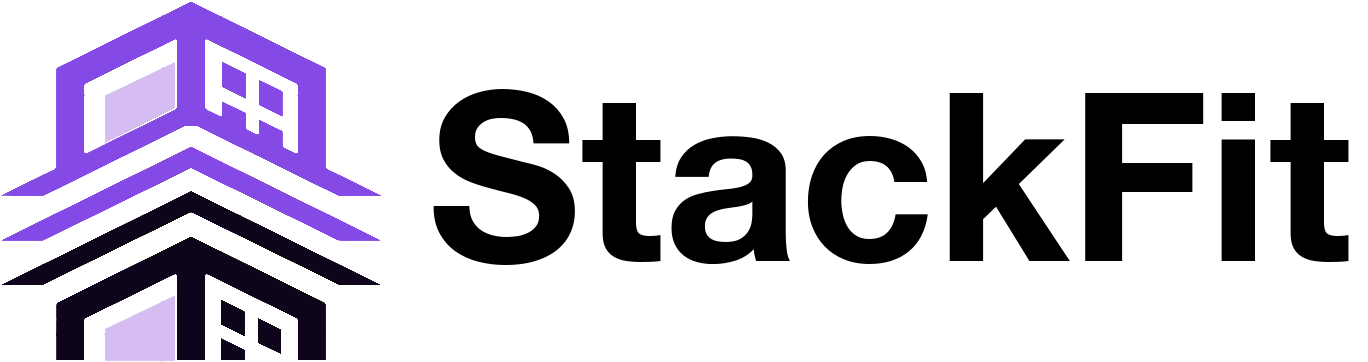Comment aligner les parties prenantes sur un plan de stacking ?
Un plan de stacking réussi exige plus qu'un simple calcul d'espace : il faut aligner toutes les parties prenantes. Découvrez comment Stackfit simplifie ce défi.
Dans tout projet de réorganisation immobilière, le plan de stacking est un outil fondamental : il matérialise la stratégie d’occupation des étages et des plateaux, en associant les équipes aux espaces disponibles. C’est une étape clé du projet, qui intervient avant le macro zoning et qui sert de base à l’aménagement futur.
Mais en pratique, cette étape, censée être purement rationnelle, se transforme souvent en un processus laborieux, source de tensions, d’allers-retours interminables, et parfois même de décisions incohérentes. Pourquoi ? Parce que le stacking n’est pas seulement une question de mètres carrés, c’est un exercice d’équilibrage d’intérêts entre une multitude d’acteurs (RH, directions métiers, directeur général, directeur immobilier...)
Un processus lent, complexe… et profondément politique
Derrière l’apparente neutralité d’un plan de stacking, se cachent des enjeux humains, stratégiques et politiques. Chaque décision, attribuer un étage à une équipe, rapprocher deux fonctions, isoler un pôle, a des implications concrètes sur la vie des collaborateurs, les dynamiques d’équipe et l’efficacité opérationnelle. Deux équipes qui étaient auparavant voisines pouvaient avoir des influences l’une sur l’autre : des inspirations ou des idées partagées autour de la machine à café, un collègue qui passe derrière votre bureau et qui intervient sur le travail en cours. Sur le papier, elles sont différentes et pourraient potentiellement être positionnées à deux étages distincts lors d’un déménagement. Mais l’entreprise perdrait en productivité si ce choix était fait. C’est pourquoi il est important de bien comprendre les besoins et les habitudes de travail des équipes avant de proposer un plan de stacking.
Qui sont les parties prenantes ?
La direction générale : elle cherche avant tout à optimiser les coûts, à valoriser les espaces, et à incarner une vision stratégique (collaboration, flexibilité, culture d’entreprise). Lorsque j'étais consultante en workplace, il était courant que la direction générale d'une entreprise nous demande de faire "passer la pilule" auprès des collaborateurs sur la diminution de la surface par poste de travail en insistant sur les bienfaits des espaces ouverts.
Les RH : elles veillent à la qualité de vie au travail, aux interactions sociales, et à l’équité entre équipes. Pour les RH, la surface par poste de travail est très importante par exemple.
Les directions métiers : elles défendent les besoins de leurs équipes, leur croissance, leur besoin de confidentialité ou de proximité avec certains services. Le point de vigilance avec les directions métiers, c’est la réticence au changement des managers, parfois acteurs du changement, parfois très réfractaires. Il est important de savoir démêler le vrai du faux lors de l’expression de leurs besoins. Certains managers peuvent dire avoir besoin de bureaux individuels pour leurs équipes, alors qu’en réalité, ils craignent l’espace ouvert.
Les IT / services généraux : ils pensent en termes de réseaux, de logistique, d’accessibilité et de contraintes techniques. Les services IT et les services généraux pensent au futur : pour eux, le nouveau plan de stacking va impacter les années à venir. Ils recherchent un maximum de flexibilité afin de limiter les coûts futurs. Ils auront ainsi tendance à privilégier une cloison mobile plutôt qu’une cloison fixe, plus simple à déplacer. Néanmoins, les cloisons fixes offrent une bien meilleure performance acoustique que les cloisons mobiles. Il faut donc trouver le juste équilibre et savoir leur expliquer les bénéfices des cloisons fixes pour le bien-être des collaborateurs, même si cela implique un espace moins flexible.
Les space planners et architectes : ils traduisent tout cela en mètres carrés et en plans réalistes. Les architectes ont tendance à réaliser le stacking rapidement afin de pouvoir passer rapidement au macro-zoning et aux plans détaillés. Il est important de les freiner et de les inviter à consacrer plus de temps à la compréhension des besoins des équipes et des différentes synergies au sein de l’entreprise, afin de proposer un plan de stacking cohérent d’un point de vue métier, et pas uniquement d’un point de vue spatial.
Chacun de ces acteurs a sa propre lecture du projet, ses propres priorités, et parfois même ses propres agendas. Le plan de stacking devient alors un terrain de négociation, voire de tensions.
Des attentes divergentes
Prenons quelques exemples : une équipe commerciale veut être proche du marketing, mais ces deux équipes n’ont pas la même taille ni les mêmes besoins de confidentialité. Par exemple, l’équipe commerciale est constamment au téléphone, ce qui pourrait perturber le travail quotidien des équipes marketing. Ou alors la direction souhaite regrouper tout le management au même étage, pour créer un “leadership floor”, mais cela implique d’éclater les équipes opérationnelles. Cela changerait le mode de fonctionnement des équipes qui se retrouveraient à un étage sans leur manager. Enfin, souvent, les RH veulent favoriser la mixité des services pour casser les silos, là où les managers préfèrent des pôles homogènes, plus simples à piloter.
Face à cela, le space planner fait de son mieux pour traduire ces contraintes sur un plan… mais sans outil adapté ni méthode collaborative, cela se transforme vite en jeu de ping-pong.
Et si on arrêtait le ping-pong ?
Traditionnellement, la création du plan de stacking suit une méthode séquentielle : le space planner collecte les besoins de chacun, produit une version du plan, qui est ensuite partagée à l’ensemble des parties prenantes. S’ensuivent des commentaires, des objections, des demandes de modifications parfois contradictoires… et le processus repart pour un tour. Deux semaines plus tard, une nouvelle version est produite, souvent déjà obsolète ou encore insatisfaisante.
Ce mode de fonctionnement présente plusieurs limites. Tout d'abord, un manque de réactivité : chaque itération prend du temps, ce qui ralentit tout le projet. Ensuite, un décrochage des parties prenantes : certaines équipes ne se sentent pas écoutées ou intégrées dans les décisions. Enfin, un décalage entre le plan et la réalité : faute de compréhension partagée, le plan validé sur le papier ne fonctionne pas toujours sur le terrain.
Résultat : on perd du temps, de l’engagement, et parfois même la confiance dans le processus.
Stackfit : un outil pour aligner rapidement, collectivement et en toute transparence
C’est dans ce contexte que Stackfit prend toute sa valeur. Conçu pour faciliter le macro-zonage interactif, Stackfit permet de construire des plans de stacking en temps réel, en intégrant les besoins, contraintes et arbitrages directement dans l’interface.
Mais Stackfit n’est pas qu’un outil technique, c’est un levier de gouvernance collaborative. Il transforme une tâche généralement descendante en un processus participatif et itératif, animé sous forme d’ateliers avec les parties prenantes.
Comment ça fonctionne ?
Lors d’un atelier de stacking avec Stackfit, chaque acteur peut exprimer ses besoins (capacités, proximité, confidentialité, adjacences…), le plan s’ajuste en direct selon les arbitrages collectifs, les contraintes sont visualisées : surcapacité, isolement d’une équipe, distance avec des fonctions clés… De plus, plusieurs scénarios peuvent être testés rapidement pour comparer les options.
On ne travaille plus “sur un fichier” qu’on envoie dans tous les sens : on co-construit la solution ensemble, avec une vision partagée et immédiate du résultat.
Les bénéfices concrets
Conclusion : de la cartographie à la co-construction
Le stacking n’est pas un simple exercice de placement : c’est un moment de convergence stratégique pour une entreprise. Trop souvent perçu comme un casse-tête technique, il mérite d’être abordé comme une démarche collective, structurée et transparente.
Avec Stackfit, on passe d’un processus lent et cloisonné à une approche fluide et participative. Ce n’est pas juste un gain de temps : c’est un changement de posture, qui place les utilisateurs au cœur de la décision. Et si, finalement, aligner les parties prenantes sur un plan de stacking n’était pas une mission impossible… mais simplement une mission mal outillée jusqu’à maintenant ?